Une plongée dans l’histoire du naissant
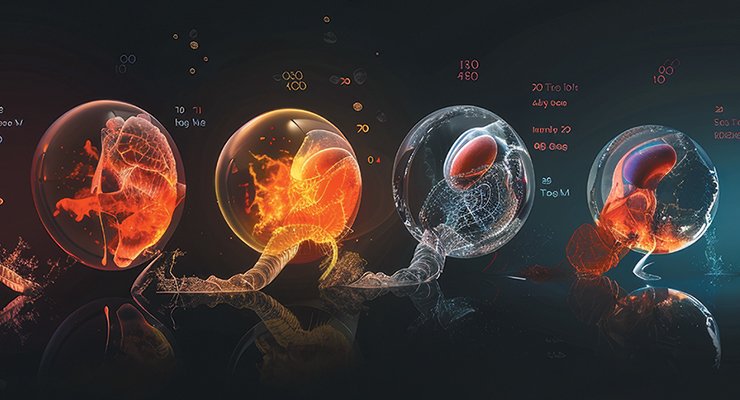
Nathalie Sage-Pranchère est historienne et chercheuse CNRS au laboratoire SPHERE. Elle faisait partie des intervenants de la table ronde du 7e Rendez-vous biomédical de l’UTC. Ses travaux de recherche portent sur l’histoire sociale de la santé à l’époque contemporaine avec une attention plus particulière sur l’histoire de la périnatalité, sur l’histoire des maladies fœtales et néonatales, ainsi que plus largement sur l’histoire des professions de santé. Rencontre !
Le Rendez-vous biomédical de l’UTC permet de mettre en contact des acteurs et des actrices essentiels de l’évolution des pratiques médicales, en plaçant au cœur du propos la finalité du travail de l’ingénierie biomédicale : améliorer la prise en charge et le vécu des pathologies par les patients, en facilitant l’action médicale sous toutes ses formes (diagnostic, dépistage, traitement, convalescence). Nathalie Sage-Pranchère tenait donc à être présente. Son prochain ouvrage portera sur l’histoire de la maladie d’incompatibilité rhésus, des premières observations à la fin du XIXe siècle à la compréhension de l’origine de la maladie avec la découverte du facteur rhésus à l’orée des années 1940. « Cette exploration du passé permet de décentrer le regard en se confrontant à des périodes et à des contextes qui défient nos évidences contemporaines (l’asepsie est une “invention” récente ; les maternités sont longtemps des lieux d’assistance et des antichambres de l’abandon…). Elle éclaire les racines de certaines pratiques actuelles (l’encadrement strict des grossesses) ou de certains positionnements professionnels (le statut médical des sages-femmes) », explique la chercheuse dont la fréquentation assidue des services de chirurgie pédiatrique dans l’enfance a nourri une curiosité profonde pour le monde médical. « Au-delà, ma découverte des enjeux contemporains de la périnatalité, de la prise en charge de la santé génésique féminine et de la santé infantile a conforté cet intérêt. Aujourd’hui, mes recherches me confrontent forcément à la question du lien entre technologie et humain, que ce soit dans mes objets d’étude ou dans ceux que je mobilise pour les produire et les faire connaître. Le regard que je porte dessus est celui d’une approche par les usages, attentive à ne pas jamais voir en la technologie une fin en soi. »
Humanisation de la médecine et sécurité du patient
L’histoire du naissant est marquée par un basculement majeur dans la seconde moitié du XVIIIe siècle lorsque des politiques commencent à être mises en œuvre à l’échelle des États européens pour améliorer les conditions de la naissance et réduire la mortalité maternelle et néonatale par la formation des sages-femmes au premier chef. Les premières pratiques de réanimation des nouveau-nés se développent à la même période. « La survie physique du naissant devient aussi précieuse que sa survie spirituelle, auparavant centrale dans des sociétés quasi unanimement chrétiennes. Cette évolution est à la racine de toutes les mutations ultérieures : prise en charge des prématurés à partir des années 1880 avec l’invention de la couveuse, développement de la protection maternelle et infantile, émergence d’une médecine fœtale de pointe avec la mise au point de techniques d’imagerie de plus en plus perfectionnées à partir des années 1970–1980, etc. », ajoute l’historienne selon qui les progrès toujours possibles en matière de mortalité infantile reposent certes sur des progrès techniques mais avant tout sur des politiques publiques attentives aux conditions de vie et de travail des femmes enceintes, ainsi qu’à la qualité et à l’accessibilité des recours médicaux pour le suivi de la grossesse et la naissance. « Tout cela implique un nombre suffisant de professionnels de santé, des investissements conséquents dans les institutions de santé, ainsi qu’une approche non comptable de l’accompagnement médical. L’humanisation de la médecine, qui est absolument compatible avec la sécurité des patients, passe également par une formation accrue des professionnels de santé aux sciences humaines et sociales afin de renforcer leur approche des patients comme des personnes et non comme des sièges de pathologie en puissance. »
KD




