Réflexions sur la greffe de visage
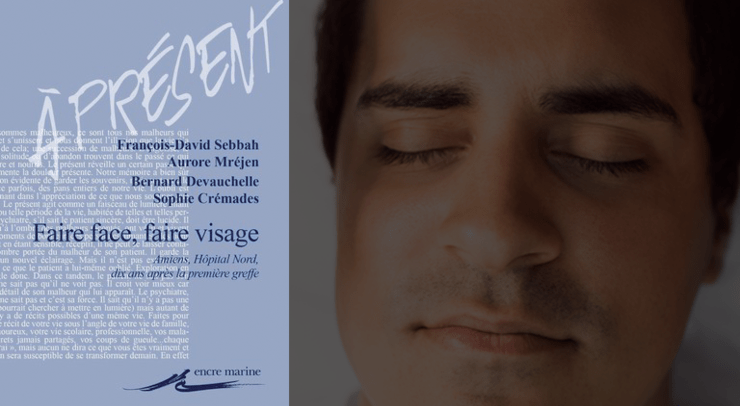
Près de treize ans après la première greffe partielle de visage réalisée par le professeur Bernard Devauchelle au CHU d’Amiens est publié l’ouvrage « Faire face, faire visage » dans la collection Encre marine des Belles Lettres. Cette aventure scientifique, technologique et humaine hors du commun se dévoile à travers des témoignages et analyses de médecins, philosophes et patients.
Le livre est l’un des supports réalisés dans le cadre du programme scientifique Technologies et traces de l’homme piloté par le laboratoire COSTECH de l’UTC qui s’est notamment interrogé sur le sujet de la transplantation. Il est le résultat d’un travail de recherche original mené par plusieurs chercheurs en Philosophie, en immersion pendant quinze jours dans le service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital d’Amiens.
Cette expérience a permis à François Sebbah, lui-même ancien directeur du laboratoire Costech et aujourd’hui professeur de philosophie morale contemporaine à l’Université Paris Nanterre et à Aurore Mréjen, docteure en Philosophie, chercheuse au LCSP (laboratoire du Changement social et politique — Paris Diderot) de confronter la théorie développée par le philosophe Emmanuel Lévinas sur le rôle du visage dans le rapport à autrui avec la réalité vécue par le personnel médical et les patients. Dépassant la simple dimension théorique, cette approche permet d’approfondir le débat au-delà de la simple problématique esthétique. Quand est-il légitime de faire courir les risques d’une greffe de visage à un patient en bonne santé ?
La réponse ne semble pouvoir être donnée qu’au cas par cas. Le texte de Sophie Crémades, psychiatre au CHU d’Amiens et les témoignages de deux personnes ayant bénéficié d’une chirurgie reconstructrice montrent le rôle complexe du visage dans l’estime de soi et ses relations avec les autres. A travers ces différents points de vue, il apparaît que le visage bien plus qu’un organe est la marque de notre humanité avec ses sentiments et sa vulnérabilité. L’équipe médicale pluridisciplinaire mobilisée autour des greffés du visage prend en compte toutes ces dimensions psychologiques et sociales.
Une approche pluridisciplinaire
Les quatre textes qui composent ce livre racontent la greffe de visage et tentent, chacun à leur manière, autant qu’ils le peuvent, de porter cette expérience à l’expression de son sens. Ils s’entrelacent et se font écho.
La troisième partie est un entretien avec Bernard Devauchelle, chef du service de chirurgie maxillo-faciale du CHU d’Amiens. Ce texte montre notamment la nécessité de concilier la virtuosité technique nécessaire à une intervention très complexe avec une compréhension de la personnalité pour restituer un visage vivant, reflet des sentiments et de l’histoire de son propriétaire. Le praticien a accueilli avec enthousiasme la mission de ces universitaires étrangers au monde médical : « L’interdisciplinarité est au cœur de notre manière de faire, depuis 20 ans nous menons des projets avec des historiens, sociologues, anthropologues et ingénieurs, nous attachons une grande importance à la recherche et à l’innovation ».
Passionné d’art, d’histoire et de philosophie, ce professeur de chirurgie atypique mène de nombreux projets extrahospitaliers avec l’Institut Faire Face — PIA — dont il est co-fondateur. Cette structure mène des recherches dans une optique à la fois médicale, technologique et humaniste. Exposition et ouvrage sur la guerre 14–18 en partenariat avec une université anglaise ou encore regards croisés sur les métiers de restaurateurs travaillant sur les visages de la cathédrale d’Amiens et celui de chirurgiens soignant des patients, les collaborations sont fécondes et ouvrent des perspectives novatrices. Le livre « Faire face, faire visage » trouve pleinement sa place au sein de ces initiatives ouvertes sur les sciences humaines et la société.
Faire face, faire visage.
Amiens, Hôpital Nord, dix ans après la première greffe.
Collection encre marine, éditions Les Belles lettres




