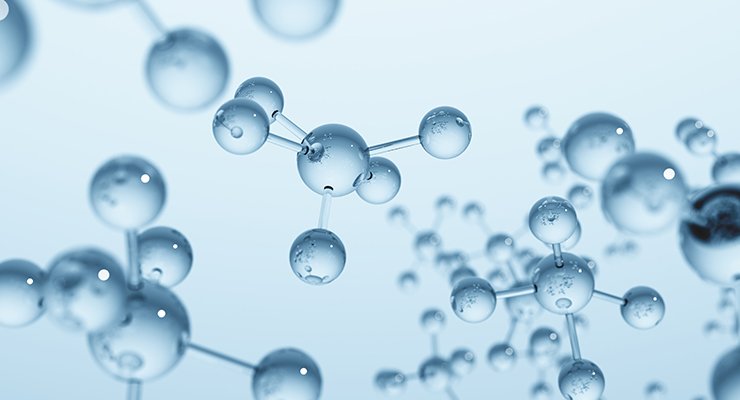
Professeur de biochimie à l’UTC, Karsten Haupt est, depuis 2012, directeur du laboratoire Génie Enzymatique et Cellulaire (GEC). Spécialiste notamment de l’impression moléculaire, il a été classé meilleur expert mondial sur cette technologie de pointe par le site ‘Expertscape’.
Une technologie qui permet de produire des ‘anticorps synthétiques’, récepteurs supramoléculaires destinés à reconnaître et à fixer des molécules cibles. Concrètement ? « Il s’agit de mouler un polymère synthétique autour d’une molécule cible individuelle (on parle alors de Template ou gabarit), qui va, de ce fait, créer une cavité dans le polymère. Ce moule mime la molécule cible que ce soit en taille, forme ou encore fonctionnalité chimique et contiendra les groupements chimiques permettant des interactions avec la molécule cible », décrit-il.
Historiquement, dans les années 80, les polymères à empreintes moléculaires (MIP pour l’acronyme anglais) ont d’abord été utilisés dans le domaine de la chimie. Mais ce n’est qu’à l’aube des années 90 qu’il y eut la première publication scientifique démontrant que l’on pouvait l’utiliser comme mimétique d’anticorps dans un test immunologique type ELISA. « Depuis, on a commencé à se servir de ces matériaux pour remplacer les anticorps biologiques dans toute application nécessitant une reconnaissance entre molécules », précise-t-il.
Dans les années 2000, l’impression moléculaire atteint un stade de maturité tel que d’autres champs d’application se sont largement ouverts. « On peut citer, entre autres, la cosmétologie, l’agroalimentaire, l’analyse environnementale, et les industries chimique et biotechnologique en général. La tendance la plus récente est une utilisation directe en médecine, en particulier en thérapie mais aussi en diagnostic. Un exemple est l’utilisation des MIP dans les biocapteurs, profitant ainsi de leur grande stabilité physique et chimique », détaille Karsten Haupt.
Ce que l’on entend par biocapteurs ? « Les biocapteurs font partie des capteurs chimiques. Ils se composent de deux parties : l’élément de reconnaissance (la ‘couche sensible’) qui reconnaît spécifiquement la molécule à détecter, et le transducteur. Ce dernier permet de traduire le signal émis lors de la fixation de la molécule cible en un signal électrique. On parle de biocapteurs lorsque l’élément de reconnaissance est une molécule biologique. Les capteurs à base de MIP en font partie. Ce sont des matériaux biomimétiques en ce sens qu’ils sont capables de mimer le comportement des récepteurs biologiques », explique-t-il. Pourquoi les biocapteurs ? « Contrairement aux laboratoires d’analyses classiques qui, en plus des investissements lourds en matériel, nécessitent des déplacements pour remettre les échantillons à analyser, les biocapteurs sont transportables. On peut ainsi les déplacer vers les échantillons, par exemple dans une ferme afin de détecter une contamination dans le lait. On peut même les implanter dans le corps humain pour la détection en continu des biomarqueurs d’une maladie, ce qui constitue un confort pour les patients souffrant notamment de maladies chroniques. Plutôt que de se déplacer régulièrement à l’hôpital, les biocapteurs permettent de mesurer, à domicile, telle ou telle molécule, comme le glucose sanguin », souligne-t-il.
Mais l’intérêt des MIP ne s’arrête pas là. Ils devraient rendre possible une médecine de plus en plus personnalisée. « On utilise en effet ces matériaux, souvent appelés anticorps synthétiques, pour cibler certaines cellules ou molécules associées à des pathologies telles les tumeurs, les inflammations ou encore les infections. Les anticorps synthétiques ont de nombreux avantages. D’abord, on n’a plus besoin d’utiliser des animaux en laboratoire ; ils sont fabriqués sur mesure pour telle ou telle cible ou maladie ; ils sont moins chers et d’une plus grande stabilité, facilitant ainsi leur ingénierie », explique Karsten Haupt.
Une technologie innovante bienvenue puisque la reconnaissance moléculaire est à la base de tous les processus qui se déroulent au sein de l’organisme humain. Une technologie chimique née de la bio-inspiration et du bio-mimétisme et qui déborde, aujourd’hui, largement le champ biologique.
D’où l’intérêt grandissant de nombre de partenaires. « On travaille notamment avec Sanofi dans le domaine de la thérapie médicale, mais aussi d’autres sociétés, hôpitaux et partenaires académiques sur des projets fondamentaux mais aussi appliqués comme le diagnostic médical et le traitement », conclut-il.




